Justice réconciliatrice
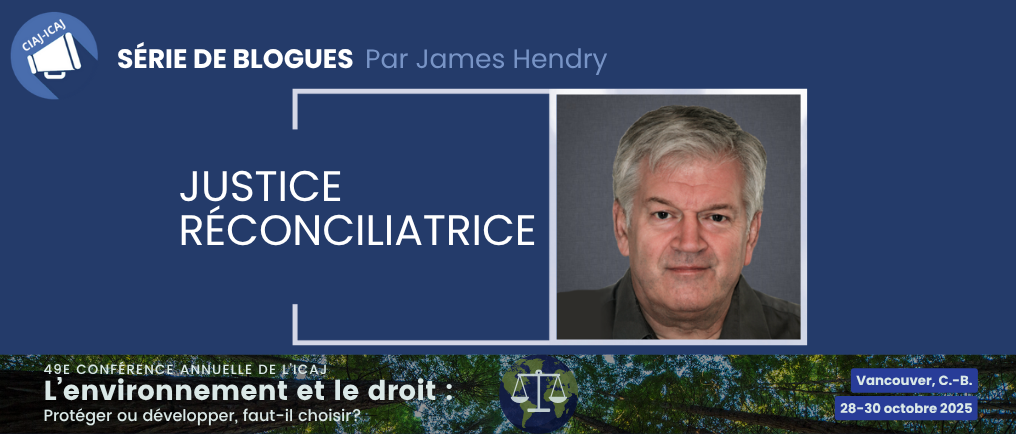
Justice réconciliatrice
Dans deux décisions inédites, la Cour suprême du Canada (CSC) a statué que le principe constitutionnel non écrit de l’honneur de la Couronne s’applique à certaines ententes contractuelles non issues de traités avec des groupes autochtones et a reconnu la réconciliation comme un principe constitutionnel dans l’affaire Québec c. Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.
Le Canada, le Québec et la Première Nation ont conclu une série d’ententes pour mettre en place un corps de police autochtone. La Première Nation a accumulé un important déficit. Elle soutenait que le Canada et le Québec avaient l’obligation de négocier le financement de la police de bonne foi et que la Couronne avait imposé un niveau de financement insuffisant en sachant qu’il ne couvrirait pas le déficit. Le Québec, de son côté, affirmait avoir respecté strictement les termes de l’entente : qu’il n’avait qu’à financer le service de police jusqu’à un montant maximal et que la Première Nation avait accepté de prendre en charge tout déficit. Le Canada a payé sa part, laissant à la CSC le soin de trancher sur l’étendue des obligations du Québec et la manière dont elles devaient être remplies.
Le juge Kasirer, s’exprimant au nom de la majorité, a identifié deux sources distinctes de responsabilité en droit privé et en droit public, applicables tant dans les juridictions de droit civil que de common law.
La première source était le droit contractuel privé. En droit civil, l’article 1375 du Code civil du Québec exige que les parties remplissent leurs obligations contractuelles de bonne foi, en tenant compte des intérêts des autres parties. J’ai déjà écrit précédemment sur ce devoir implicite d’exécuter les contrats de bonne foi, autant en droit civil qu’en common law.
La deuxième source, plus novatrice, repose sur l’honneur de la Couronne. En droit civil, ce principe s’applique quand la Couronne traite avec les peuples autochtones, en vertu de l’article 1376 du Code civil du Québec, qui lie l’État aux obligations privées ainsi qu’à « d’autres règles applicables », incluant la common law publique. Il découle de la relation particulière entre la Couronne et les peuples autochtones, fondée sur la nécessité de réconcilier la souveraineté de la Couronne avec la souveraineté autochtone préexistante. Cette obligation relève du droit public et est distincte des obligations du droit privé, puisqu’elle ne repose pas sur l’intention des parties, mais sur le risque d’atteinte à la relation spéciale entre la Couronne et les peuples autochtones.
Le juge Kasirer a élaboré un critère pour appliquer ce principe à des contrats spécifiques non issus de traités. La jurisprudence a montré que la Couronne doit agir avec honneur lorsque le contrat concerne des différences philosophiques, des traditions et des pratiques culturelles des peuples autochtones, et lorsqu’il touche à une revendication crédible d’un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, en se basant sur la ligne de décisions de l’affaire de la Nation Haida qui oblige la Couronne à agir de manière honorable de manière proportionnelle à la force de la revendication. L’honneur de la Couronne ne modifie pas les termes d’un accord ni ne crée de cause d’action ; cependant, il impose un standard de performance plus élevé que celui de la simple bonne foi dans l’exécution d’un contrat. Par exemple, la Couronne ne peut pas être intransigeante ni profiter du déséquilibre dans la relation.
Le juge Kasirer a déclaré que les termes des ententes successives créaient une relation à long terme où le financement du corps de police serait réévalué et renégocié à chaque renouvellement. Il a mis en évidence un terme spécifique d’un renouvellement typique où les parties étaient en désaccord : le texte prévoyait que la contribution de la Couronne était plafonnée pour une année financière et que la Première Nation devait absorber tout déficit. Toutefois, il a déterminé que l’ensemble du texte envisageait des ententes successives renouvelables pour maintenir le service de police, ce qui créait une obligation spécifique de renégocier le financement chaque fois que les parties renouvelaient leur relation contractuelle, sachant qu’elle pouvait être résiliée à tout moment.
Le juge Kasirer a affirmé que le Québec avait violé son devoir contractuel de négocier de bonne foi découlant de l’obligation textuelle spécifique de négocier : le Québec avait été intransigeant en refusant de manière déraisonnable de négocier de façon authentique lors des renouvellements successifs. La Première Nation avait une attente légitime de pouvoir négocier le financement pour soutenir son corps de police et ses objectifs d’autonomie gouvernementale face aux déficits dont le Québec était au courant. Le juge Kasirer a poussé plus loin en concluant que l’insistance du Québec sur les termes stricts de l’entente, qui limitaient sa contribution et déchargeaient le déficit sur la Première Nation, constituait un abus de ses droits contractuels, car il avait refusé de négocier une réduction du déficit de l’année précédente. Les sommes supplémentaires versées par le Québec pour maintenir la police, en dehors des négociations de renouvellement prévues par le texte, n’ont pas modifié la conclusion de mauvaise foi.
Le juge Kasirer a soutenu que les faits établissant la violation du contrat constituaient également une violation de l’honneur de la Couronne. Ce principe s’appliquait parce que les ententes avaient été conclues dans un esprit de réconciliation, afin de fournir des services policiers culturellement appropriés là où la police provinciale était mal perçue, et pour soutenir la revendication d’autonomie gouvernementale en matière de sécurité intérieure. Fait intéressant, le juge Kasirer s’est appuyé sur un projet d’accord en principe sur l’autonomie gouvernementale et les débats entourant l’amendement à la législation sur la police du Québec comme preuve que le Canada et le Québec reconnaissaient la revendication de la Première Nation à un droit crédible à l’autonomie gouvernementale pour des services de police autogérés. Le Québec n’a pas respecté le standard élevé de conduite en raison des dommages que ses actions ont causés à la relation entre la Couronne et les peuples Autochtones à long terme, relation qui soutient la réconciliation.
Les deux sources de responsabilité mènent à deux préjudices différents à réparer, chacun faisant l’objet d’une analyse propre.
Le juge Kasirer a estimé que les preuves ne lui permettaient pas de déterminer les dommages pour violation de contrat. La « justice corrective » compensait la restitution complète des conséquences immédiates, directes et prévisibles de la violation. Ici, les preuves n’ont pas permis de démontrer que les négociations auraient annulé le déficit ni d’évaluer l’effet de l’aide financière supplémentaire du Québec. Le juge Kasirer a écrit qu’il aurait dû renvoyer l’affaire au juge de première instance pour une évaluation appropriée.
Cependant, le renvoi était inutile en raison de la violation de l’honneur de la Couronne.
La réparation pour ne pas avoir agi avec honneur a amené le juge Kasirer à développer le concept de « justice réconciliatrice », qui visait moins à compenser les torts passés qu’à restaurer la relation à long terme entre la Couronne et les peuples autochtones sur la voie de la réconciliation. La réparation s’intéresse à la viabilité à long terme de la communauté autochtone en tant que culture distincte, en allant au-delà de la résolution formelle des revendications pour privilégier la négociation. Le juge Kasirer estimait qu’un recours en droit contractuel privé ne serait pas proportionnel aux intérêts distincts protégés par le devoir de la Couronne d’agir honorablement dans sa relation avec les peuples autochtones. Le refus du Québec de s’engager dans des négociations significatives avait endommagé la relation de la Couronne avec la Première Nation, qui se sentait « un couteau sur la gorge » en devant accepter un financement insuffisant, mettant en péril ses objectifs d’autonomie, sa dignité, la qualité de ses services policiers, ou même la dissolution de son corps de police et le retour à la police provinciale. Une réparation proportionnelle au dommage causé à la relation aurait pris en compte la possibilité que des négociations aient permis à la Première Nation d’obtenir le montant du déficit : le montant des dommages-intérêts ordonnés.
La Cour continue son chemin vers la réconciliation de la souveraineté antérieure des peuples autochtones avec celle de l’imposition de la souveraineté de la Couronne, en développant le droit des principes constitutionnels non écrits pour mieux reconnaître la dignité autochtone dans la Constitution sous le nouveau concept de « justice réconciliatrice ». Elle a judicieusement maintenu le devoir d’exécuter les contrats en droit privé de bonne foi distinct des ententes avec les peuples autochtones, où les différences autochtones nécessitent une portée plus large pour reconnaître la question de la dignité, qui fait partie du devoir de la Couronne d’agir honorablement dans une relation à long terme, et pas seulement de manière transactionnelle dans un contrat privé.


